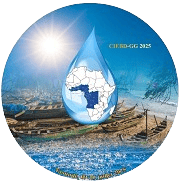
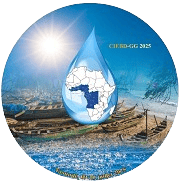

1. L'économie bleue est un concept qui promeut la gestion durable des ressources aquatiques pour le développement économique et social. Elle s’inscrit dans une dynamique juridique et institutionnelle internationales qui, remontant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, s’est imposée dans le narratif mondial sur le développement avec la Conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 de 2012, et l'adoption en 2015 des Objectifs de développement durable (ODD).
2. Suivant cette dynamique l'Union africaine (UA) a adopté la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans (Stratégie AIM 2050) dans le cadre de son Agenda 2063, ainsi qu'un plan d'action pour sa mise en œuvre.
3. Ces cadres soulignent le potentiel des océans à stimuler une croissance économique respectueuse de l'environnement, en plaçant la durabilité au cœur des politiques économiques mondiales. La résolution 66/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui fait suite à Rio+20, encourage les pays à élaborer des stratégies nationales et régionales pour l'exploitation durable des ressources marines afin de renforcer la croissance économique, l'inclusion sociale et les moyens de subsistance tout en préservant la durabilité des océans et des côtes.
4. L'ODD 14 intitulé « conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable », souligne l'importance de la conservation et de l'exploitation durable des ressources marines, en complément des ODD 1, 8 et 5.
5. Dans la même logique, la troisième conférence des Nations unies sur les océans, organisée conjointement par la France et le Costa Rica du 8 au 13 juin 2025, fournira des indications supplémentaires sur la voie à suivre pour faire progresser l'ODD 14
6. En Afrique, trente-huit sur les 55 pays sont des États côtiers. Avec plus de 90 % des échanges commerciaux qui se font par voie maritime, le continent abrite plusieurs des corridors commerciaux stratégiques, qui contribuent à accroître son importance stratégique sur le plan mondial.
7. Dans le contexte africain, l'économie bleue englobe l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques aussi bien dans le milieu marin que dans les eaux douces à savoir les océans, les mers, les lacs, les rivières, les aquifères, les côtes et les rivages. Ses activités liées directement ou indirectement à l’économie bleue vont de la pêche et de l'aquaculture au tourisme, au transport, à la construction navale, à l'énergie et à la bioprospection.
8. Conscient du vaste potentiel aquatique du continent, l'Union africaine considère les océans et les mers d'Afrique comme la "nouvelle frontière de la renaissance africaine". Dans son Agenda 2063, l’organisation continentale fait de l'économie bleue, une priorité pour la construction d’une “Afrique fondée sur une croissance inclusive et sur un développement durable”. A cet effet, l’UA a adopté en 2019, la stratégie AIM 2050 et la stratégie africaine pour l'économie bleue.
9. Au-delà des initiatives de l’UA, il est important de souligner qu’il existe plusieurs autres dynamiques et alliances sous-régionales relatives à l’économie bleue, parmi lesquelles l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (OMAOC), le Comité des pêches du centre-ouest du Golfe de Guinée (CPCOG) et la Commission du Golfe de Guinée.
10. Le 25 juin 2013, la Commission du Golfe de Guinée, la CEDEAO et les membres de la CEEAC ont adopté un code de conduite pour lutter contre la piraterie, les vols à main armée et les activités maritimes illégales lors du sommet de Yaoundé sur la sécurité et la sûreté maritimes.
11. Au niveau sous-régional, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), a entrepris plusieurs actions institutionnelles en faveur de la promotion de l’économie bleue. Il s’agit, entre autres, de l’élaboration d’une stratégie de l’économie bleue adoptée en 2023, de la promotion de l’Economie bleue dans le Plan Stratégique Indicatif à Moyen Terme (2021-2025), du renforcement de la gouvernance des océans et de l’organisation d’une conférence sur le développement de l'économie bleue en janvier 2022.
12. Les Etats côtiers, membres de la CEEAC, représentent environ 2 000 kilomètres de littoral avec une zone économique exclusive (ZEE) cumulée de 715 500 km2. Un tel potentiel marin et aquatique offre d’énormes possibilités en termes de prospérité économique et sociale. Cependant les nombreuses pesanteurs demeurent au regard des défis subsistant en termes d'adaptation au climat, des impacts liés à l'activité humaine et la préservation de l'écosystème.
13. Des initiatives telles que le Fonds bleu du bassin du Congo (2017), le Plan régional de sécurité maritime de la CEEAC (2013) et la Commission des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC) visent à pallier à ces pesanteurs et à assurer la gestion durable des ressources et la conservation de la biodiversité.
14. Malgré les progrès accomplis, il convient d’observer que la structuration des filières liées à l’économie bleue demeure très faible et les échanges régionaux très limités.
15. La Conférence de Yaoundé 2019 a été une première initiative de synergie des efforts en matière de gestion de la mer et des océans en Afrique centrale. Afin de tirer davantage profit de la Conférence de 2019, le Cameroun s'engage à réunir les pays d'Afrique centrale pour une nouvelle conférence en juillet 2025, dont l'objectif principal sera d'élaborer un projet de résolution à soumettre à l'Union africaine et à l'Assemblée générale des Nations unies sur la gestion de l'économie bleue en Afrique centrale.
16. La conférence internationale sur l’économie bleue dans le Golfe de Guinée, que le Cameroun co-organisation avec le Bureau de la 79ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies s’inscrit dans la poursuite des efforts liées à la promotion de l’Economie bleue en Afrique.